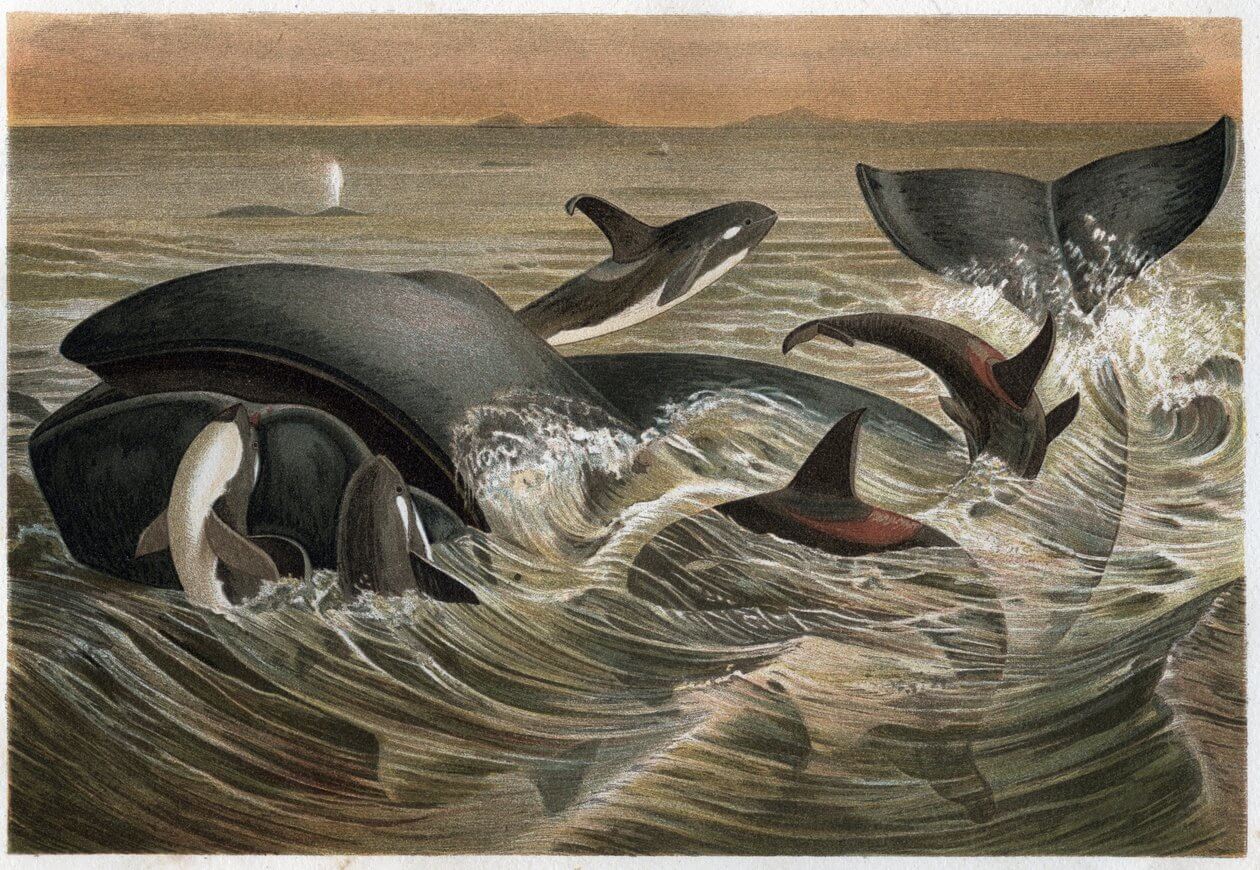Pour certaines espèces, oui, le Saint-Laurent est un lieu de reproduction. Pour d’autres, il s’agit seulement d’un garde-manger où elles viennent se remplir la panse avant de regagner des eaux plus chaudes où elles se reproduiront et mettront bas.
Le béluga, seul cétacé résidant du Saint-Laurent, s’accouple au printemps, soit d’avril à juin, et les naissances ont lieu environ un an plus tard. Lors de l’accouplement, les mâles formeraient des coalitions pour les aider à « convaincre » une femelle de copuler. Le 23 août, trois bélugas s’activaient en surface: deux mâles et une femelle, et parmi les éclaboussures, on remarquait des têtes, des queues, des nageoires pectorales et des pénis roses. Accouplement ou jeux sociaux? Difficile à dire. Ce comportement est rarement documenté et peu connu. Ces observations sont précieuses et permettent de mieux comprendre la reproduction des bélugas. Pour les curieux, la « scène » a été filmée:
Les marsouins communs s’accouplent entre juillet et août, alors qu’ils sont abondants dans le Saint-Laurent. La gestation dure environ 10 mois et les naissances ont lieu au printemps suivant, alors qu’ils sont… de retour dans le Saint-Laurent, après un hiver probablement au large des côtes atlantiques! C’est à peu près le même scénario pour les autres « petites » baleines à dents: dauphin à nez blanc, dauphin à flancs blancs, globicéphale noir.
Pour les autres espèces qui fréquentent le Saint-Laurent l’été, l’accouplement et les naissances se dérouleraient ailleurs, au cours de l’hiver. Les cachalots mâles rejoignent les groupes de femelles sous les tropiques; les rorquals à bosse se regroupent dans les Caraïbes; les baleines noires gagnent les eaux chaudes de la Géorgie et de la Floride aux États-Unis… et les autres rorquals? Le mystère plane toujours. Selon des suivis acoustiques américains, les rorquals communs seraient dispersés dans l’Atlantique Nord. Les rorquals bleus s’entendraient depuis les Grands Bancs de Terre-Neuve jusqu’aux Bermudes, et certains passeraient même des hivers dans le Saint-Laurent. Les petits rorquals, eux, se déplaceraient vers les Antilles l’hiver, sans se regrouper.
En savoir plus: